 Boubekeur Ait Benali , 30 mai 2007
Boubekeur Ait Benali , 30 mai 2007
Le 8 mai 1945, dans tous les pays vainqueurs du nazisme, la joie était indescriptible et incommensurable. En effet, la capitulation avait scellé la fin d’un
cauchemar ayant duré plus de cinq longues années. L’information sur la chute de Berlin, la signature de Reims, la fin des combats s’était propagée telle une traînée de poudre. Et pourtant,
l’Algérie ce jour-là s’engouffrait dans un précipice. Les autorités coloniales avaient demandé la célébration de la victoire alliée sur tout le territoire, terre française selon eux, aux couleurs
de la France et de ses alliés, mais avaient, en même temps, interdit aux autres de déployer leur emblème. L’historien français Jean-Louis Planche pose alors la question : « Mais sera-t-il
possible, un jour pareil, d’exalter la passion nationaliste des uns et de refréner celle des autres ? ».
Pour répondre à cette question, il faut essayer de comprendre comment la politique coloniale avait évolué jusqu’à cette période précise. Eh bien, les recherches
menées ont montré que les colonialistes exerçaient une domination sans vergogne sur les Algériens arabo-bérberes. Durant toute la période coloniale ceux-là exigeaient de ceux-ci une soumission
sans réserves. Pour les colonialistes la seule conduite possible était celle décrite par l’historienne Annie Rey Goldzeiguer en parlant de contact entre le colon et l’Algérien : « le contact, le
colon l’a nécessairement, car il ne peut se passer de la main d’œuvre. Il vit de et par les Algériens dont il partage de façon inégalitaire le sol ». Néanmoins, pour élucider ce qui s’était passé
en 1945, il est important qu’il y ait au moins, selon moi, trois parties à décrire. En effet, pour comprendre le parcours des Algériens et des colonialistes depuis la défaite française de 1940
jusqu’aux massacres de Sétif et Guelma, posons la question de savoir comment a été d’abord accueillie la nouvelle de la défaite de part et d’autre ? Pendant les cinq années qui ont suivi la
défaite, beaucoup de choses avaient évidemment bougé notamment l’évolution des positions sur la guerre et sur l’avenir de l’Algérie. Le 8 mai n’était-il pas la conséquence du non rapprochement
des visions des uns et des autres ? Et quelle a été la réaction du régime colonial au lendemain de la manifestation ?
En effet, après la défaite française, les Français d’Algérie trouvaient en Pétain le chef qui allait leur rendre le peu d’espace perdu lors du simulacre de réformes
du front populaire. Pour eux, la défaite n’était que celle de la troisième république qui avait perdu du terrain face à la gauche, leur ennemie jurée. Partant, cette défaite était par ricochet
leur victoire. Louis Bertrand a résumé le sentiment général des Français d’Algérie : « Nous Français somme chez nous en Algérie. Nous nous sommes rendus maîtres du pays par la force. Nous avons
pu organiser le pays et cette organisation affirme encore l’idée de supériorité du vainqueur sur le vaincu, du civilisé sur l’homme inférieur. Nous sommes les légitimes propriétaires du pays
».
Quant aux Algériens, cette défaite avait scindé le courant nationaliste indépendantiste en deux. Le courant majoritaire représenté par Messali selon lequel un
soutien au nazisme aurait conduit à une autre forme de domination. Donc pas de compromis avec Hitler. Et un autre groupe de jeunes militants du PPA, en créant le comité d’action révolutionnaire
nord-africaine (CANRA) dirigé par Belkacem Radjef et Mohamed Taleb, avait demandé aux Allemands de les former. Non que Messali ait refusé de collaborer mais avait sommé les membres du CANRA de
démissionner du parti.
Désormais, la situation provoquée par l’occupation de la France avait laissé les colonialistes davantage maîtres du pays. Dans une note remise au Maréchal Pétain,
au retour d’une tournée en Afrique du nord, l’Amiral Darlan avait écrit : « L’indigène de l’Algérie surtout est misérable. Cela éclate à l’œil nu quand on parcourt les rues d’Alger ». Cette
situation était due à l’accélération des exportations de nourriture en direction de la France et pour l’entretien de l’armée allemande. Comparant le niveau de vie des habitants d’Algérie, A.R.
Goldzeiguer précise : « la comparaison avec l’aisance des colons et la nourriture de leurs troupeaux alimente la colère générale. Les jeunes, surtout, comprennent que pour échapper à la faim et à
la misère, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et ils vont écouter les discours des jeunes militants qui parlent de luttes politiques et veulent se libérer du joug colonial. ». Par ailleurs,
à partir de 1942, une infime minorité des Français d’Algérie avait commencé à suivre le combat auquel appelait le général de Gaulle. En réponse à cette invitation, le journal Echo d’Oran de
septembre 1942 se permettait même l’insulte : « quant à vous, monsieur de Gaulle, qui traînez dans la honte et dans le sang les lambeaux d’un uniforme français, vous êtes un misérable, un traître
et un assassin ». Quant aux Algériens, la position était péremptoire. Avant qu’une quelconque mobilisation soit décrétée et sachant, par ailleurs, que l’indigène n’était utilisé, par le passé,
que pour se servir de chair à canon, un message avait été signé par Ferhat Abbas et par quelques notables, le 22 décembre 1942. Il avait été remis aux autorités et aux alliés en demandant : «
avant que les musulmans d’Algérie ne consentent aux sacrifices que l’entrée en guerre annonce, ces derniers demandent qu’ils soient assurés de se battre pour leur propre affranchissement
politique et ne restent pas privés des droits et des libertés essentielles dont jouissent les autres habitants de ce pays ».
Ainsi, la mobilisation du début 1943 avait eu un écho favorable auprès des Algériens : 173000 hommes dont 87500 engagés avait constitué leur apport à l’effort de
guerre. En revanche, moins d’un an après cet élan, la nomination du général Catroux avait mis fin à l’espoir d’une émancipation réelle. Pour A.R Goldzeiguer, l’internement des chefs aurait
permis, pensait-il (Catroux), de stopper toute velléité des militants à demander des réformes. Il s’agissait, à l’époque, des réformes qui n’allaient pas au delà de l’égalité comme l’a écrit
Belaid Abdeslam dans son livre, le hasard et l’histoire : « ce n’était pas toujours facile, parce que, pour le milieu intellectuel de l’époque, parler de l’indépendance de l’Algérie était quelque
chose de déraisonnable : il fallait être un fou pour parler de cela ».
Pour toute réponse, le CFLN (le Comité Français pour la Libération Nationale), organisme dirigeant la France combattante, avait proposé quelques réformes, mais de
Gaulle avait fermé la porte, d’après goldzeiguer, à toute idée d’indépendance ou même d’autonomie des colonies et avait rejeté toute possibilité d’évoluer hors du bloc de l’empire. En effet, la
réforme du 7 mars 1944 avait permis l’octroi du statut de citoyen à quelque 60000 "indigènes". Il y avait en outre le partage des Algériens en deux collèges. Le premier comportait les Français
auquel il intégrait les musulmans de droit français. Le second réunissait une masse qui deviendra, en 1962, le peuple algérien indépendant. Par ailleurs, une semaine après avoir pris connaissance
de ces réformes, le mouvement des Amis du Manifeste et de la Liberté était créé. Le mouvement s’était fixé comme objectif de rassembler tous les Algériens. Pari réussi puisque en un temps record
le mouvement avait enregistré plus de 500000 adhérents. Dans son congrès du 2au 4 mars 1945, les trois tendances du mouvement du mouvement y participaient, à savoir le PPA, les ulémas et les
partisans de Ferhat Abbas. La résolution adoptée était la suivante : « le bureau regrette que le manifeste et son additif établis par tous les élus et représentants musulmans à la demande des
pouvoirs publics,le 23 juin 1943, ait été repoussé et n’ait provoqué que la réforme électorale du 7 mars 1944 ».
Le mois de mai avait été le plus grand malheur que l’Algérie ait connu jusqu’alors. A vrai dire, les massacres avaient commencé bien avant le 8. Car avant de fêter
l’armistice, les Algériens voulaient comme à l’accoutumée célébrer la fête du travail. Lors des différents défilés, sur tout le territoire national, un mot d’ordre revenait tel un leitmotiv :
libérer les prisonniers politiques. Les slogans dénonçaient également la déportation de Messali à Brazaville. A Sétif le cortège était estimé à prés de 5000 personnes, chiffre cité par le
commissaire divisionnaire M. Bergé. D’après le même rapport la dispersion s’était faite dans le calme. A Guelma, le comité des AML avait demandé de s’intégrer dans le cortège de la CGT, mais les
dirigeants syndicaux, d’après J.L Planche, avaient refusé nettement. Ainsi à Guelma la marche avait revêtu un autre cachet : Les responsables avaient demandé aux indigènes de marcher
silencieusement. Il faut noter qu’à Sétif et Guelma, il n’y avait aucun incident à déplorer.
En revanche les manifestants d’Alger et d’Oran avaient payé une lourde facture en exaltant leur joie. En effet, à Alger, les forces de police avait établi des
barrages et tiraient sur les manifestants dés l’apparition du drapeau algérien. Lors d’une enquête menée par Henri Alleg : « il y avait eu quatre morts et sept autres qui ne survivront que
quelques jours à leur blessure ». Ce même jour un autre fait a été relevé par A.R Goldzeiguer : « les Européens des abords de la rue d’Isly ont non seulement barricadé leurs balcons, mais des
coups de feu ont été tirés sur les manifestants ». À Oran également, l’intervention de la police avait provoqué une bagarre qui s’était terminée par un mort et plusieurs blessés du coté des
manifestants.
Pendant toute la semaine des rencontres avaient lieu, du coté des nationalistes, pour évaluer la situation provoquée par la répression d’Alger et d’Oran. En effet,
le 8 mai 1945, Beaucoup de comités AML, selon J.L Planche, avaient renoncé à manifester en Oranie et dans l’Algérois pour éviter sans doute à leurs coreligionnaires les accrochages sanglants du 1
mai. En plus de cela, le complot dit Gazagne, du nom du secrétaire général du gouvernement général, avait éliminé à Alger et à Oran les cadres dirigeants et les militants les plus solides des AML
et du PPA. Par contre, à Sétif et à Guelma où, le 1 mai ayant été sans incidents, la proposition d’organiser un défilé n’avait suscité aucune méfiance. Ainsi, à Guelma et à Sétif les gens
allaient à la marche sans douter qu’un cauchemar les attendait.
A Sétif, le 8 mai, à 8 heures du matin, environs 2000 personnes étaient rassemblées devant la mosquée de la gare. Profitant du jour du marché hebdomadaire, les
organisateurs avaient rappelé aux paysans venus des villages de déposer tout ce qui pouvait être une arme (coteau, hache, faux...). Derrière les drapeaux des alliés, les jeunes scouts étaient au
premier rang suivis des porteurs de la gerbe de fleurs, et les militants suivaient juste derrière pour éviter tout débordement de la masse paysanne. A la vue d’un drapeau algérien, d’après le
général Tubert, celui-ci avait été déployé en cours de route, les policiers avaient jailli du barrage et avaient attaqué la foule pour s’emparer du drapeau. Un militant avait expliqué que le
drapeau étant sacré, il est impossible de le remiser une fois sorti. Selon J.L Planche : « c’est à ce moment que tout dérape quand un inspecteur tire, tue le porte drapeau et deux coups de feu en
soutien partent du café de France. Dans la panique provoquée par les premiers coups de feu, à d’autres fenêtres des Européens tirent à leur tour sur la foule ». Bien que la panique ait gagné
l’ensemble des manifestants, un militant avait sonné le clairon pour que la gerbe de fleurs soit déposée. Cela se passait à 10 heures du matin. Le car de la gendarmerie ayant eu du retard était
arrivé et s’était dirigé en direction des manifestants fauchant les présents, écrit A.R. Goldzeiguer.
A Guelma, à 16 heures, un rassemblement s’était organisé hors de la ville. Les militants AML attendaient, en fait, les instructions venant de Annaba. A 17 heures le
cortège s’était ébranlé avec les pancartes célébrant la victoire des alliés ainsi que leurs drapeaux entourant l’algérien. Arrivé à l’actuelle rue du 8 mai, le cortège avait été arrêté par le
sous préfet Achiary. Pour Boucif Mekhaled, il ne restait plus que 500 mètres pour atteindre le monument aux morts. Le sous préfet, Achiary -futur chef de l’OAS créé à Madrid en 1961 -, hors de
lui avait intimé l’ordre de jeter les pancartes, drapeaux et banderoles. Un socialiste nommé Fauqueux avait râlé auprès du sous préfet : « alors, monsieur le sous préfet est ce qu’il y a ici la
France ou pas ? ». selon J.L Planche : « comme sous un coup de fouet, Achiary saisit le revolver dont il s’est armé, entre dans la foule droit sur le porte drapeau et tire. Son escorte ouvre le
feu sur le cortège qui s’enfuit, découvrant dans son reflux le corps du jeune Boumaza ».
Cependant, suite aux assassinats à Sétif et à Guelma, des groupes d’Algériens avaient, dans leur repli, tué des Européens qui n’étaient pas forcément les plus
hostiles à leur émancipation. La réponse française à la colère des indigène ne s’était, en tout cas, pas fait attendre en mobilisant les forces de police, de gendarmerie, des miliciens et des
militaires.
Déjà le 9 mai, à Sétif, 35 Algériens ont été abattus parce qu’ils ne savaient pas qu’un couvre feu avait été établi. Le rapport du commissaire divisionnaire, M.
Bergé, expliquait que chaque mouvement jugé suspect provoquait le tir. Dans une enquête effectuée par M. Esplass le 15 mai sur la localité de Sétif disait : « les musulmans ne peuvent circuler
sauf s’ils portent un brassard blanc délivré par les autorités et justifications d’un emploi dans un service public. »
Le 9 mai, à Guelma, la milice dirigée par Achiary avait tenu sa première séance au cours de laquelle l’adjoint Garrivet proposait : « Nous allons étudier la liste
des personnes à juger. Commençons par nos anciens élèves ». Selon A.R Goldzeiguer : « la perquisition au local des AML a permis de saisir les listes nominatives des responsables et militants,
tous suspects, qui seront incarcérés, souvent torturés, et exécutés par fournée ».
D’ailleurs, dans un article signé Guy Pervillé, professeur à l’université de Toulouse (dans un de ses livres il a essayé de prouver que les harkis étaient six fois
supérieurs au nombre de combattants en omettant de dire que la majorité des Algériens était pour le FLN), reconnaît que la répression des manifestations était féroce. Il admet la conclusion de
Marcel Reggui selon laquelle le sous préfet Achiary et le préfet de Constantine avaient fait disparaître les cadavres des victimes dans des fours à chaux. En effet, à Héliopolis -village baptisé
par le général Bedeau au début de la conquête estimant qu’il fallait renvoyer les Algériens pour faire installer les colons-, le 21 mai, la gendarmerie avait décidé de nettoyer la ville de Guelma
avant l’arrivée du ministre de l’intérieur de l’époque, Adrien Tixier. J.L planche explique la manœuvre du sous préfet Achiary : « avec l’avenue de l’été, la chaleur monte. Faute de les avoir
tous enterrés assez profond ou brûlés, trop de cadavres ont été jetés dans un fossé, à peine recouverts d’une pelletée de terre. Les débris humains sont transportés par camion. Le transport est
effectué avec l’aide de la gendarmerie de Guelma pendant la nuit. Les restes des 500 musulmans ont été amenés au lieu dit (fontaine chaude) et brûlés dans un four à chaux avec des branches
d’oliviers. Le four appartient à monsieur Lepori ».
Pendant six semaines les autorités coloniales avaient utilisé tous les moyens pour aller au bout d’une résistance inexistante. Le 11 mai, trois B26 avaient
intervenu à la bombe et à la mitrailleuse pour, croyait-on, dégager la ville. Selon A.R goldzeiguer, le général Weiss, chef de la cinquième région aérienne, avait ordonné le 13 mai le
bombardement des rassemblements des indigènes sur les routes et à proximité des villages. L’aviation, disait-il(Weiss), avait aidé à déloger les rebelles des positions qu’ils occupaient dans des
régions inaccessibles. La marine non plus n’était pas restée à l’écart. En effet, dés le 10 mai, les fusiliers avaient débarqué dans la région de Cap Aokas. Au crépuscule, les tirs répétés
résonnaient jusqu’à Alger.
Par ailleurs, pour justifier cette intervention musclée, les autorités coloniales avaient essayé d’imputer la responsabilité des massacres aux AML et au PPA qui
voulaient préparer une insurrection. Mais, après la saignée du complot Gazagne consistant à arrêter les vrais responsables du PPA, ce parti pouvait-il lancer un mot d’ordre alors que son
encadrement était paralysé et son président déporté au Congo ? Quant aux AML, le matin même du 8 mai, son président et son secrétaire général, Ferhat Abbas, s’étaient rendus au siège du
gouvernement général pour féliciter les autorités de la victoire des alliés. Autre fait à signaler : le seul haut responsable PPA en liberté était Debaghine. Plus tard, dans une réunion du bureau
clandestin, Debaghine a justifié sa non implication aux événements : « comment aurais-je pu prendre la responsabilité d’une insurrection alors que je venais d’envoyer mon père et ma femme à Sétif
où ils se trouvaient le 8 mai ». Pour prouver que les événements du 8 mai étaient un complot ourdi par le secrétaire du gouvernement général, A.R Goldzeiguer se demande dans son livre pourquoi, à
l’intérieur du quadrilatère (Béjaia, Constantine, Annaba, Souk Ahras), la région située entre Sétif et Guelma, n’a-t-elle pas connue une flambée de violence des deux points chauds ? Elle répond :
« l’émeute n’a pas gagné ces villes et centres pourtant très politisés, tenus en main par les AML et surtout par le PPA ». Les rapports ultérieurs ont même disculpé les responsables du PPA en
disant que ces derniers avaient joué un rôle modérateur et avaient évité des affrontements à Constantine par exemple.
Pour conclure, on peut retenir que les événements de Sétif et Guelma étaient un résultat de l’accumulation des causes remontant jusqu’à la conquête et à la
domination effrénée des colons. De façon générale, la colonisation en Algérie a été régie par la violence et les responsables n’incarnaient nullement la dimension de la civilisation française. En
1884 déjà, le rapport de Jules ferry était nettement clair : « il est difficile de faire entendre au colon européen qu’il existe d’autres droits que les siens en pays arabe, et que l’indigène
n’est pas taillable et corvéable à merci. Si la violence n’est pas dans les actes, elle est dans le langage et dans les sentiments. On sent qu’il gronde encore au fond des cœurs un flot mal
apaisé de rancune, de dédain et de crainte ».
Autre point que le régime colonial avait négligé était flagrant. En effet, malgré les efforts fournis par les Algériens, lors des deux guerres mondiales, pour que
la France ait pu garder son rang de puissance mondiale, les Français d’Algérie voyaient dans toutes les réformes un danger qui les guettait. D’ailleurs, en commentant les réformes du mois de mars
1944, un professeur de droit à la faculté d’Alger expliquait à ses étudiants : « ce n’est pas l’Islam qui est venu à la citoyenneté française, c’est elle qui s’est pliée jusqu’à lui ». Enfin,
bien que les causes politiques n’aient pas été considérées plus tard comme fondées, les chantres du coloniasme se rabattaient alors sur les causes économiques. Or à Sétif, par exemple, la zone
sud, plus sèche n’avait pas trop bougé. Par contre la zone nord, bien arrosée et riche, la révolte s’était répandue telle une traînée de poudre. La meilleure explication a été donnée par A.R
Goldzeiguer : « il est remarquable que le mouvement insurrectionnel n’ait pas gagné des régions aussi sensibles que le sud Constantinois, le sud algérois, le littoral. Le soulèvement du 8 mai est
un moindre mal, car il est une fausse manœuvre. Il aurait été autrement tragique si le PPA y avait participé ». Le seul succès colonial c’est que cette fois-ci le sang pur ait abreuvé leurs
sillons.
Sources :
Annie Rey- Goldzeiguer:aux origines du mouvement national,
Jean Louis planche : 8 mai 1945, un massacre annoncé,
Boucif Mekhaled : chroniques d'un massacre,
Marcel Reggui :les massacres de Guelma Revue “Histoire” avril 2007.
 « Si les peuples sont heureux sous la forme de leur gouvernement, ils
le garderont. S’ils sont malheureux, ce ne seront ni vos opinions, ni les miennes, ce sera l’impossibilité de souffrir davantage et plus longtemps qui les déterminera à le changer, mouvement
salutaire que l’oppresseur appellera révolte.» Diderot : Histoire des deux Indes.
« Si les peuples sont heureux sous la forme de leur gouvernement, ils
le garderont. S’ils sont malheureux, ce ne seront ni vos opinions, ni les miennes, ce sera l’impossibilité de souffrir davantage et plus longtemps qui les déterminera à le changer, mouvement
salutaire que l’oppresseur appellera révolte.» Diderot : Histoire des deux Indes.

 Le comité révolutionnaire pour l’unité et l’action
(CRUA) a eu, certes, une courte existence mais l’immense œuvre qu’il a réalisée restera indéfiniment indélébile dans la mémoire algérienne. Né de la scission du parti nationaliste, le MTLD
(mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques), il a tenu à ressouder, dans le premier temps, les rangs du parti avant de s’engager dans une perspective d’action armée en vue de
soustraire le pays du giron colonial. Bien que certains membres du comité central aient accompagné ce comité dans le seul but de contrarier Messali, président du parti, il n’en reste pas moins
que les partisans de la voie neutraliste ont su gérer, avec intelligence, cette période cruciale en l’orientant dans le sens de rassembler toutes les forces vives de la nation.
Le comité révolutionnaire pour l’unité et l’action
(CRUA) a eu, certes, une courte existence mais l’immense œuvre qu’il a réalisée restera indéfiniment indélébile dans la mémoire algérienne. Né de la scission du parti nationaliste, le MTLD
(mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques), il a tenu à ressouder, dans le premier temps, les rangs du parti avant de s’engager dans une perspective d’action armée en vue de
soustraire le pays du giron colonial. Bien que certains membres du comité central aient accompagné ce comité dans le seul but de contrarier Messali, président du parti, il n’en reste pas moins
que les partisans de la voie neutraliste ont su gérer, avec intelligence, cette période cruciale en l’orientant dans le sens de rassembler toutes les forces vives de la nation. Le code communal
ayant régi les premières assemblées locales a été adopté le mois de janvier 1967, soit cinq ans après l'indépendance du pays. Il faut dire que les luttes intestines pour le contrôle des
institutions ont handicapé le pays pendant un temps relativement important. Ainsi, dans le journal officiel du 18 janvier, le conseil de la révolution, dirigé par feu Boumediene, avait justifié
les motifs de la dite loi en mentionnant que « la commune est la cellule de base de la nation ». Mais, pourquoi attendre cinq ans pour qu'une loi définissant le socle du pays soit votée ? Dans le
texte publié dans le JO, aucune raison na été avancée pour expliquer ce retard. En revanche, selon Ahmed Rouadjia, auteur de « Grandeur et décadence de l'Etat algérien », il y avait une espèce de
dichotomie entre lidéologie incarnée par le conseil et sa pratique. Il note d'ailleurs à ce propos qu « au lendemain de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, les collectivités locales
fonctionnaient selon des règles héritées du régime colonial et que, jusqu'à ce jour, les communes restent régies par une série de textes confus pris par l'ancienne puissance occupante, avec le
seul souci d'étendre et d'organiser la colonisation ». Malgré ce retard, les premières élections municipales de l'Algérie indépendante, où l'empreinte du conseil de la révolution était latente,
ont eu lieu enfin en février 1967 et mai 1969. Il a été exigé notamment des candidats un engagement indéfectible au service de la révolution socialiste. C'est à partir de la troisième élection
locale de février 1971, d'après A. Rouadjia, que le conseil de la révolution a abandonné son rôle, de désignation des candidats, au profit du parti qui, lui-même, se battait pèle mêle pour
l'attachement sans vergogne de l'Algérie au régime socialiste. Par ailleurs, jusqu'à avril 1990, le code communal n'a pas connu aucune fluctuation. Pendant ce temps-là, les élections se suivaient
et se ressemblaient. Après l'ouverture démocratique de 1988, survenu au forceps, un nouveau code communal a vu le jour. A vrai dire celui-ci a reconduit peu ou prou les mêmes dispositions. La
nouveauté, et elle est de taille, se situe au niveau de l'autorité du wali. Ce dernier a vu ses prérogatives plus affirmées que par le passé. En cas de litige avec l'assemblée communale, le wali
peut trancher le différend sans qu'il tienne compte de l'avis de celui qui a été élu dans sa localité. La nouvelle donne a effectivement bousculé les habitudes en Algérie. On rentre désormais
dans une phase d'intrigues et de pièges. A partir de ce moment-là le parti unique n'était et n'est plus le seul parti en lice lors des joutes électorales. Du coup, les autorités ont mis en place
un ensemble de barrières pour s'assurer le contrôle pérenne du pouvoir à tous les échelons. Elles n'ont pas négligé non plus le risque de voir les islamistes devenir maitres des collectivités
locales. Ainsi, le renforcement des pouvoirs du walis sur les communes est interprété par certains observateurs comme étant un piège tendu à l'opposition en général et aux islamistes du FIS en
particulier. Ces derniers étaient les premiers à réagir. Une marche a été organisée par ceux-ci exhortant les autorités à leur débloquer de l'argent nécessaire pour tenir leurs promesses
électorales. En tout cas c'était leur mot dordre. Toutefois, depuis l'interruption du processus électoral de décembre 1991, les maires se sont aperçus (excepté sans doute les élus de la
coalition) de la perte non négligeable de leur pouvoir au bénéfice de la fonction exécutive. Désormais, l'article 92 fait du wali « un représentant de l'Etat » et « délégué du gouvernement au
niveau de la wilaya ». Bien que la loi ait laissé des miettes aux élus, en cas de litige, le dernier mot revient toujours au wali. La loi de Zerhouni ne rétablit pas l'équilibre si ce n'est
d'accorder plus de pouvoirs aux secrétaires généraux des assemblées communales. Pour conclure, il va de soi que les élections du 29 novembre prochain ne s'inscriront que dans la continuité.
Certes, le citoyen est appelé à choisir ses représentants, mais personne n'est dupe pour considérer que le pouvoir réel sorte des urnes.
Le code communal
ayant régi les premières assemblées locales a été adopté le mois de janvier 1967, soit cinq ans après l'indépendance du pays. Il faut dire que les luttes intestines pour le contrôle des
institutions ont handicapé le pays pendant un temps relativement important. Ainsi, dans le journal officiel du 18 janvier, le conseil de la révolution, dirigé par feu Boumediene, avait justifié
les motifs de la dite loi en mentionnant que « la commune est la cellule de base de la nation ». Mais, pourquoi attendre cinq ans pour qu'une loi définissant le socle du pays soit votée ? Dans le
texte publié dans le JO, aucune raison na été avancée pour expliquer ce retard. En revanche, selon Ahmed Rouadjia, auteur de « Grandeur et décadence de l'Etat algérien », il y avait une espèce de
dichotomie entre lidéologie incarnée par le conseil et sa pratique. Il note d'ailleurs à ce propos qu « au lendemain de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, les collectivités locales
fonctionnaient selon des règles héritées du régime colonial et que, jusqu'à ce jour, les communes restent régies par une série de textes confus pris par l'ancienne puissance occupante, avec le
seul souci d'étendre et d'organiser la colonisation ». Malgré ce retard, les premières élections municipales de l'Algérie indépendante, où l'empreinte du conseil de la révolution était latente,
ont eu lieu enfin en février 1967 et mai 1969. Il a été exigé notamment des candidats un engagement indéfectible au service de la révolution socialiste. C'est à partir de la troisième élection
locale de février 1971, d'après A. Rouadjia, que le conseil de la révolution a abandonné son rôle, de désignation des candidats, au profit du parti qui, lui-même, se battait pèle mêle pour
l'attachement sans vergogne de l'Algérie au régime socialiste. Par ailleurs, jusqu'à avril 1990, le code communal n'a pas connu aucune fluctuation. Pendant ce temps-là, les élections se suivaient
et se ressemblaient. Après l'ouverture démocratique de 1988, survenu au forceps, un nouveau code communal a vu le jour. A vrai dire celui-ci a reconduit peu ou prou les mêmes dispositions. La
nouveauté, et elle est de taille, se situe au niveau de l'autorité du wali. Ce dernier a vu ses prérogatives plus affirmées que par le passé. En cas de litige avec l'assemblée communale, le wali
peut trancher le différend sans qu'il tienne compte de l'avis de celui qui a été élu dans sa localité. La nouvelle donne a effectivement bousculé les habitudes en Algérie. On rentre désormais
dans une phase d'intrigues et de pièges. A partir de ce moment-là le parti unique n'était et n'est plus le seul parti en lice lors des joutes électorales. Du coup, les autorités ont mis en place
un ensemble de barrières pour s'assurer le contrôle pérenne du pouvoir à tous les échelons. Elles n'ont pas négligé non plus le risque de voir les islamistes devenir maitres des collectivités
locales. Ainsi, le renforcement des pouvoirs du walis sur les communes est interprété par certains observateurs comme étant un piège tendu à l'opposition en général et aux islamistes du FIS en
particulier. Ces derniers étaient les premiers à réagir. Une marche a été organisée par ceux-ci exhortant les autorités à leur débloquer de l'argent nécessaire pour tenir leurs promesses
électorales. En tout cas c'était leur mot dordre. Toutefois, depuis l'interruption du processus électoral de décembre 1991, les maires se sont aperçus (excepté sans doute les élus de la
coalition) de la perte non négligeable de leur pouvoir au bénéfice de la fonction exécutive. Désormais, l'article 92 fait du wali « un représentant de l'Etat » et « délégué du gouvernement au
niveau de la wilaya ». Bien que la loi ait laissé des miettes aux élus, en cas de litige, le dernier mot revient toujours au wali. La loi de Zerhouni ne rétablit pas l'équilibre si ce n'est
d'accorder plus de pouvoirs aux secrétaires généraux des assemblées communales. Pour conclure, il va de soi que les élections du 29 novembre prochain ne s'inscriront que dans la continuité.
Certes, le citoyen est appelé à choisir ses représentants, mais personne n'est dupe pour considérer que le pouvoir réel sorte des urnes.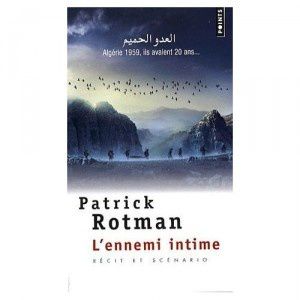 La chaîne
publique française, France 3, a consacré les soirées du 9 et 16 septembre 2007, aprés le Soir3, à la diffusion du film: « les ennemis intimes ». Il s’agit de l’œuvre de l’historien et
réalisateur, Patrick Rotman, relatant les violences dans la guerre d’Algérie.
La chaîne
publique française, France 3, a consacré les soirées du 9 et 16 septembre 2007, aprés le Soir3, à la diffusion du film: « les ennemis intimes ». Il s’agit de l’œuvre de l’historien et
réalisateur, Patrick Rotman, relatant les violences dans la guerre d’Algérie. La guerre
d’Algérie a été régie pendant plus vingt mois sur la base d’un seul document, en l’occurrence la déclaration du 1 novembre 1954. Et pourtant il ne s’agissait ni d’une omission ni d’une négligence
de la part des initiateurs de la lutte armée. En effet, une réunion a été prévue pour le début janvier 1955 afin qu’il soit fait le point sur l’avancement de la lutte. Mais la terrible répression
de l’armée française et l’absence sur le sol national du coordinateur des cinq régions, Mohamed Boudiaf, parti au Caire pour rejoindre la délégation extérieure, ont rendu la tenue de cette
réunion délicate.
La guerre
d’Algérie a été régie pendant plus vingt mois sur la base d’un seul document, en l’occurrence la déclaration du 1 novembre 1954. Et pourtant il ne s’agissait ni d’une omission ni d’une négligence
de la part des initiateurs de la lutte armée. En effet, une réunion a été prévue pour le début janvier 1955 afin qu’il soit fait le point sur l’avancement de la lutte. Mais la terrible répression
de l’armée française et l’absence sur le sol national du coordinateur des cinq régions, Mohamed Boudiaf, parti au Caire pour rejoindre la délégation extérieure, ont rendu la tenue de cette
réunion délicate. Le Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) a décidé de célébrer la fin du joug colonial, dans tout le territoire algérien, le 5 juillet 1962. Cette date a été choisie effectivement de façon symbolique pour
boucler 132 ans de domination française. Et pourtant le vote s'est déroulé le 1er juillet 1962 où la participation a été remarquablement élevée. En effet, pour sortir définitivement du giron
colonial, les Algériens ont voté oui à 91,23% par rapport aux inscrits et 99,72% par rapport aux votants. Le général De Gaulle a reconnu officiellement l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet.
Le 5 juillet, comme prévu, la fête s'est déroulée dans l'allégresse partout en Algérie hormis la ville d'Oran. Ce qui a terni, en effet, cette journée c'étaient les événements survenus à Oran où
l'organisation de l'armée secrète (OAS) a décidé de marquer cette journée par une ultime fusillade, sans doute de trop. Par conséquent les Oranais ont assisté à une journée cauchemardesque
contrairement à leurs concitoyens qui ont manifesté leur exaltation pour la fin de l'occupation dans l'hilarité, et ce, à travers les quatre coins du pays. Pour apporter quelques éléments
pouvant aider à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, un bref retour en arrière est primordial. En effet, plusieurs hypothèses ont été avancées par les historiens des deux rives de la
Méditerranée pour illustrer cette affaire. Celle qui semble correspondre au contexte de l'époque est celle de B.Stora, car elle résume l'état d'esprit des pieds-noirs à la veille de
l'indépendance algérienne, il écrit à ce propos : « il semble impensable à la majorité de la population européenne de quitter leur pays natal, de concevoir une indépendance sous l'égide du FLN «.
L'OAS n'a pas lésiné sur les moyens, aidée en cela par les pieds-noirs, pour parvenir à ses objectifs, notamment le regroupement de la population européenne dans une plate forme territoriale.
L'idée en tout cas n'était pas née ex nihilo mais lors de la conférence de presse du général de Gaulle du 11 avril 1961 où la partition a été évoquée. Selon Xavier Yacono : « pour la première
fois, de Gaulle élevait, de façon ferme, la menace de regroupement des populations qui resteraient fidèle à la France «. La majorité des pieds-noirs avait par ailleurs la détermination
inébranlable de livrer le combat jusqu'à l'ultime moment pour sauver l'Algérie française, notamment dans les grandes métropoles telles que Alger et plus spécifiquement Oran. La violence des
ultras avait franchi maintes fois le rubican lors des derniers mois de la présence française a été sans doute déterminante lors de la célébration de l'indépendance. L'historienne Michèle
Villanueva n'essaye-t-elle pas d'expliquer l'événement en disant : « le 5 juillet ne serait-il pas le contrecoup des mois terribles que la population algérienne venait de vivre ? ».
Cependant, depuis les accords du cessez-le-feu, l'OAS n'a pas cessé de perpétrer des attentats dans le but de rééditer le basculement de l'armée française en sa faveur comme ce fut le cas
le 13 mai 1958. A cet effet, la ville d'Oran a été considérée, par les ultras, la plus à même de relever ce défi. La raison invoquée était qu'Oran, par le nombre d'habitants français majoritaires
dans la ville, il était plus facile d'atteindre l'objectif consistant à retourner le rapport de forces en leur faveur dans un délai succinct. Le général commandant la région oranaise, Joseph
Katz, estime que l'OAS par sa politique de terre brûlée, ses assassinats, aurait pu déclencher une riposte des Algériens, obligeant les troupes françaises à intervenir pour protéger les
Européens, et empêchant la mise en application sur le terrain du cessez-le-feu. Bien que le général Katz soit considéré l'ennemi numéro un des pieds-noirs, il n'en demeure pas moins qu'il était
le plus dur dans le combat qui l'opposait aux Algériens, au début de la révolution, avant qu'il soit rappelé en France en 1958 pour ne pas avoir soutenu les événements du 13 mai. Il a expliqué
dans son livre le plan qu'il avait mis en place, en 1957, pour en finir rapidement avec la rébellion algérienne le plus tôt possible. Il a proposé ensuite au général Salan (chef des armées à ce
moment-là) d'étendre ce plan anti-guérilla pour, dit-il, écraser ceux qui voulaient bouter les Français d'Algérie. En revanche, dans ses fonctions du maintien de l'ordre à Oran face aux éléments
de l'OAS, il a toujours recommandé à ses officiers de mener leur mission d'une façon diamétralement opposée à celle qu'ils avaient déjà employées jusque-là. Il l'avoue implicitement quand il
écrit : « si nous faisions ce qui nous est imputé, l'ordre serait rétabli en 48 heures à Oran. N'ayant pas en face de nous des ennemis, mais des Français trompés et abusés, nous ne pouvons, nous
ne voulons régler les problèmes par la force des armes ». Cependant, à partir du cessez-le-feu, et profitant de l'étau desserré, les quartiers européens étaient difficilement contrôlables
par l'armée française qui ne voulait pas verser le sang français. De l'autre côté, l'ALN ne trouvait aucun mal à contrôler les siens suivant l'engagement d'arrêt des combats qu'elle a signé.
Cette situation a créé un climat de violence inouïe des ultras. Du coup, les Algériens vivaient continûment sous l'épée de Damoclès des exactions de ceux-là. Le responsable de la sécurité
de la ville, le général Katz, admet que les bévues des ultras allaient crescendo du cessez-le-feu jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Il affirme que : « d'innocentes victimes continuent à tomber
dans la proportion d'un Européen pour cent Arabes ; parmi les victimes nombre de femmes et d'enfants «. Néanmoins, ce chiffre n'est apparemment pas partagé par d'autres historiens à l'instar de
B.Stora qui affirme qu'au mois de mai, à Oran, « quotidiennement, de 10 à 50 Algériens sont abattus par l' OAS. Certains musulmans quittent Oran pour rejoindre leurs familles dans les villages ou
villes n'ayant pas une forte population européenne «. Quant à ceux qui étaient contraints de rester, la violence à laquelle ils étaient exposés n'épargnait ni femme, ni enfant. En parlant des
Algériennes qui servaient dans les familles françaises comme Fatmas, le général Katz , confirme que celles qui osaient se rendre dans les quartiers européens le payaient de leur vie. Ainsi,
ajoute-t-il « nombre d'entre elles n'en reviennent plus. On trouve leurs cadavres allongés au bord des trottoirs «. Le 15 mai, le chiffre de 15 femmes abattues a été enregistré pour la seule
ville d'Oran. Dans la dernière ligne droite pour parvenir à l'indépendance, le FLN a essayé tant bien que mal de retenir les Algériens qui voulaient venger les leurs. La difficulté était
immense car il s'agissait de convaincre les gens de supporter les violences quotidiennes des ultras. En fait, à des obus de mortier qui tombaient sur les quartiers algériens, où pour la
seule journée du 26 mai, l'OAS a causé plus de 30 morts et une centaine de blessés, le FLN a organisé, selon Jean Monneret, des rapts en fonction d'un objectif simple : combattre l'OAS.
D'ailleurs, le proverbe français ne dit-il pas que : « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise ». Quant à d'autres bévues commises par d'autres Algériens, à vrai dire ceux que
l'on nomme les maquisards de la vingt cinquième heure, le Général Katz l'explique comme suit : « Depuis le cessez-le-feu 126 FSNA(français de souche nord- africaine) ont déserté leurs unités en
emportant armes et bagages. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils ne rejoignent pas tous l'ALN et beaucoup vont grossir les bandes incontrôlables qui se livrent à des exactions de toutes sortes ».
Au fur et à mesure que la date du référendum approchait, et que les chances du basculement de l'armée en faveur de l'OAS s'amenuisaient, les ultras n'avaient qu'une chose en tête : casser
l'économie algérienne. Au cours des différentes émissions radio pirates de l'OAS, la consigne de tout détruire était maintes fois donnée : « s'il faut quitter l'Algérie on la laissera dans l'état
où les premiers colons l'ont trouvée en 1830 ». Jusqu' à la fin du mois de juin la destruction de toutes les infrastructures a été poursuivie avec le plus grand acharnement. En fait, tout ce qui
est nécessaire et vital pour le pays : bâtiments et édifices publics, installations industrielles et portuaires et réseaux de communication. Le 22 juin, par exemple, c'était au tour du
palais de justice que les commandos OAS ont remis le feu après qu'il a résisté aux flammes la première fois. Dans la soirée c'était l'Hôtel de ville qui a été la proie des flammes. Même la
bibliothèque n'a pas échappé au feu. La journée du 24 juin a battu tous les records selon le général Katz : « De tous les quartiers jaillissent des panaches de fumée et des flammes, prélude à
l'explosion des réservoirs de mazout du port qui, le lendemain, plongera la ville dans une semi-obscurité ». Enfin, malgré le calme relatif observé les deux derniers jours du mois de juin
suite à la création d'un comité de réconciliation, personne ne croyait, en son for intérieur, à un apaisement définitif de la situation vécue les mois précédents. C'est ainsi que le capitaine de
l'ALN, Djelloul Nemmiche dit Bakhti a interdit, le 2 juillet, toute manifestation dans le centre ville avant le 5 juillet afin que les conditions soient réunies et que la fête se déroule sans
anicroche. Dès les premières heures de la matinée du 5 juillet, les Algériens se sont donnés rendez-vous pour manifester dans l'allégresse l'indépendance durement acquise. Aux environs de
midi, des coups de feu sont tirés sur des Algériens qui voulaient hisser le drapeau algérien à la place d'armes. Cette fusillade a été sans doute celle de trop car la riposte ne s'est pas fait
attendre non plus. Le bilan de la journée est lourd en vie humaine. En effet, pour brève qu'ait été la riposte( environ 30 minutes d'après le général Katz) à laquelle a participé des ATO
(auxiliaires temporaires occasionnels) et même des civils algériens, le nombre de morts était tout de même important. Il y avait 25 morts parmi les Français (46 selon Fouad Soufi) et plus de 80
Algériens. Ainsi la colonisation s'est achevée comme elle avait commencé en 1830, c'est-à-dire dans le sang.
Le Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) a décidé de célébrer la fin du joug colonial, dans tout le territoire algérien, le 5 juillet 1962. Cette date a été choisie effectivement de façon symbolique pour
boucler 132 ans de domination française. Et pourtant le vote s'est déroulé le 1er juillet 1962 où la participation a été remarquablement élevée. En effet, pour sortir définitivement du giron
colonial, les Algériens ont voté oui à 91,23% par rapport aux inscrits et 99,72% par rapport aux votants. Le général De Gaulle a reconnu officiellement l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet.
Le 5 juillet, comme prévu, la fête s'est déroulée dans l'allégresse partout en Algérie hormis la ville d'Oran. Ce qui a terni, en effet, cette journée c'étaient les événements survenus à Oran où
l'organisation de l'armée secrète (OAS) a décidé de marquer cette journée par une ultime fusillade, sans doute de trop. Par conséquent les Oranais ont assisté à une journée cauchemardesque
contrairement à leurs concitoyens qui ont manifesté leur exaltation pour la fin de l'occupation dans l'hilarité, et ce, à travers les quatre coins du pays. Pour apporter quelques éléments
pouvant aider à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, un bref retour en arrière est primordial. En effet, plusieurs hypothèses ont été avancées par les historiens des deux rives de la
Méditerranée pour illustrer cette affaire. Celle qui semble correspondre au contexte de l'époque est celle de B.Stora, car elle résume l'état d'esprit des pieds-noirs à la veille de
l'indépendance algérienne, il écrit à ce propos : « il semble impensable à la majorité de la population européenne de quitter leur pays natal, de concevoir une indépendance sous l'égide du FLN «.
L'OAS n'a pas lésiné sur les moyens, aidée en cela par les pieds-noirs, pour parvenir à ses objectifs, notamment le regroupement de la population européenne dans une plate forme territoriale.
L'idée en tout cas n'était pas née ex nihilo mais lors de la conférence de presse du général de Gaulle du 11 avril 1961 où la partition a été évoquée. Selon Xavier Yacono : « pour la première
fois, de Gaulle élevait, de façon ferme, la menace de regroupement des populations qui resteraient fidèle à la France «. La majorité des pieds-noirs avait par ailleurs la détermination
inébranlable de livrer le combat jusqu'à l'ultime moment pour sauver l'Algérie française, notamment dans les grandes métropoles telles que Alger et plus spécifiquement Oran. La violence des
ultras avait franchi maintes fois le rubican lors des derniers mois de la présence française a été sans doute déterminante lors de la célébration de l'indépendance. L'historienne Michèle
Villanueva n'essaye-t-elle pas d'expliquer l'événement en disant : « le 5 juillet ne serait-il pas le contrecoup des mois terribles que la population algérienne venait de vivre ? ».
Cependant, depuis les accords du cessez-le-feu, l'OAS n'a pas cessé de perpétrer des attentats dans le but de rééditer le basculement de l'armée française en sa faveur comme ce fut le cas
le 13 mai 1958. A cet effet, la ville d'Oran a été considérée, par les ultras, la plus à même de relever ce défi. La raison invoquée était qu'Oran, par le nombre d'habitants français majoritaires
dans la ville, il était plus facile d'atteindre l'objectif consistant à retourner le rapport de forces en leur faveur dans un délai succinct. Le général commandant la région oranaise, Joseph
Katz, estime que l'OAS par sa politique de terre brûlée, ses assassinats, aurait pu déclencher une riposte des Algériens, obligeant les troupes françaises à intervenir pour protéger les
Européens, et empêchant la mise en application sur le terrain du cessez-le-feu. Bien que le général Katz soit considéré l'ennemi numéro un des pieds-noirs, il n'en demeure pas moins qu'il était
le plus dur dans le combat qui l'opposait aux Algériens, au début de la révolution, avant qu'il soit rappelé en France en 1958 pour ne pas avoir soutenu les événements du 13 mai. Il a expliqué
dans son livre le plan qu'il avait mis en place, en 1957, pour en finir rapidement avec la rébellion algérienne le plus tôt possible. Il a proposé ensuite au général Salan (chef des armées à ce
moment-là) d'étendre ce plan anti-guérilla pour, dit-il, écraser ceux qui voulaient bouter les Français d'Algérie. En revanche, dans ses fonctions du maintien de l'ordre à Oran face aux éléments
de l'OAS, il a toujours recommandé à ses officiers de mener leur mission d'une façon diamétralement opposée à celle qu'ils avaient déjà employées jusque-là. Il l'avoue implicitement quand il
écrit : « si nous faisions ce qui nous est imputé, l'ordre serait rétabli en 48 heures à Oran. N'ayant pas en face de nous des ennemis, mais des Français trompés et abusés, nous ne pouvons, nous
ne voulons régler les problèmes par la force des armes ». Cependant, à partir du cessez-le-feu, et profitant de l'étau desserré, les quartiers européens étaient difficilement contrôlables
par l'armée française qui ne voulait pas verser le sang français. De l'autre côté, l'ALN ne trouvait aucun mal à contrôler les siens suivant l'engagement d'arrêt des combats qu'elle a signé.
Cette situation a créé un climat de violence inouïe des ultras. Du coup, les Algériens vivaient continûment sous l'épée de Damoclès des exactions de ceux-là. Le responsable de la sécurité
de la ville, le général Katz, admet que les bévues des ultras allaient crescendo du cessez-le-feu jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Il affirme que : « d'innocentes victimes continuent à tomber
dans la proportion d'un Européen pour cent Arabes ; parmi les victimes nombre de femmes et d'enfants «. Néanmoins, ce chiffre n'est apparemment pas partagé par d'autres historiens à l'instar de
B.Stora qui affirme qu'au mois de mai, à Oran, « quotidiennement, de 10 à 50 Algériens sont abattus par l' OAS. Certains musulmans quittent Oran pour rejoindre leurs familles dans les villages ou
villes n'ayant pas une forte population européenne «. Quant à ceux qui étaient contraints de rester, la violence à laquelle ils étaient exposés n'épargnait ni femme, ni enfant. En parlant des
Algériennes qui servaient dans les familles françaises comme Fatmas, le général Katz , confirme que celles qui osaient se rendre dans les quartiers européens le payaient de leur vie. Ainsi,
ajoute-t-il « nombre d'entre elles n'en reviennent plus. On trouve leurs cadavres allongés au bord des trottoirs «. Le 15 mai, le chiffre de 15 femmes abattues a été enregistré pour la seule
ville d'Oran. Dans la dernière ligne droite pour parvenir à l'indépendance, le FLN a essayé tant bien que mal de retenir les Algériens qui voulaient venger les leurs. La difficulté était
immense car il s'agissait de convaincre les gens de supporter les violences quotidiennes des ultras. En fait, à des obus de mortier qui tombaient sur les quartiers algériens, où pour la
seule journée du 26 mai, l'OAS a causé plus de 30 morts et une centaine de blessés, le FLN a organisé, selon Jean Monneret, des rapts en fonction d'un objectif simple : combattre l'OAS.
D'ailleurs, le proverbe français ne dit-il pas que : « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise ». Quant à d'autres bévues commises par d'autres Algériens, à vrai dire ceux que
l'on nomme les maquisards de la vingt cinquième heure, le Général Katz l'explique comme suit : « Depuis le cessez-le-feu 126 FSNA(français de souche nord- africaine) ont déserté leurs unités en
emportant armes et bagages. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils ne rejoignent pas tous l'ALN et beaucoup vont grossir les bandes incontrôlables qui se livrent à des exactions de toutes sortes ».
Au fur et à mesure que la date du référendum approchait, et que les chances du basculement de l'armée en faveur de l'OAS s'amenuisaient, les ultras n'avaient qu'une chose en tête : casser
l'économie algérienne. Au cours des différentes émissions radio pirates de l'OAS, la consigne de tout détruire était maintes fois donnée : « s'il faut quitter l'Algérie on la laissera dans l'état
où les premiers colons l'ont trouvée en 1830 ». Jusqu' à la fin du mois de juin la destruction de toutes les infrastructures a été poursuivie avec le plus grand acharnement. En fait, tout ce qui
est nécessaire et vital pour le pays : bâtiments et édifices publics, installations industrielles et portuaires et réseaux de communication. Le 22 juin, par exemple, c'était au tour du
palais de justice que les commandos OAS ont remis le feu après qu'il a résisté aux flammes la première fois. Dans la soirée c'était l'Hôtel de ville qui a été la proie des flammes. Même la
bibliothèque n'a pas échappé au feu. La journée du 24 juin a battu tous les records selon le général Katz : « De tous les quartiers jaillissent des panaches de fumée et des flammes, prélude à
l'explosion des réservoirs de mazout du port qui, le lendemain, plongera la ville dans une semi-obscurité ». Enfin, malgré le calme relatif observé les deux derniers jours du mois de juin
suite à la création d'un comité de réconciliation, personne ne croyait, en son for intérieur, à un apaisement définitif de la situation vécue les mois précédents. C'est ainsi que le capitaine de
l'ALN, Djelloul Nemmiche dit Bakhti a interdit, le 2 juillet, toute manifestation dans le centre ville avant le 5 juillet afin que les conditions soient réunies et que la fête se déroule sans
anicroche. Dès les premières heures de la matinée du 5 juillet, les Algériens se sont donnés rendez-vous pour manifester dans l'allégresse l'indépendance durement acquise. Aux environs de
midi, des coups de feu sont tirés sur des Algériens qui voulaient hisser le drapeau algérien à la place d'armes. Cette fusillade a été sans doute celle de trop car la riposte ne s'est pas fait
attendre non plus. Le bilan de la journée est lourd en vie humaine. En effet, pour brève qu'ait été la riposte( environ 30 minutes d'après le général Katz) à laquelle a participé des ATO
(auxiliaires temporaires occasionnels) et même des civils algériens, le nombre de morts était tout de même important. Il y avait 25 morts parmi les Français (46 selon Fouad Soufi) et plus de 80
Algériens. Ainsi la colonisation s'est achevée comme elle avait commencé en 1830, c'est-à-dire dans le sang. Boubekeur Ait Benali , 30 mai 2007
Boubekeur Ait Benali , 30 mai 2007 Par Aït Benali Boubekeur 18 mars 2007
Par Aït Benali Boubekeur 18 mars 2007