
Depuis l’accession du pays à la souveraineté, l’Algérie ne s’est jamais retrouvée dans une situation embarrassante comme celle du 11 janvier 1992. Il s’agit, pour rappel, de l’annulation des élections législatives que le régime a lui-même organisées. En effet, l’armée est intervenue pour mettre fin au processus électoral, dont le premier tour s’est déroulé le 26 décembre 1991, remporté haut la main par le FIS (Front islamique du Salut). Bien que la classe politique se soit divisée sur l’arrêt du processus électoral, force est de constater, 22 ans plus tard, que la libéralisation politique a pris un sérieux coup, avec notamment le lot de restrictions liées à l’état d’urgence. Par ailleurs, lors de ces élections –et c’est le moins que l’on puisse dire –, les Algériens pensaient choisir eux-mêmes leurs représentants. Et c’est là bien sûr le but des élections. En effet, le citoyen met une pression sur le ses gouvernants afin qu’ils réalisent leurs desiderata. Dans le cas contraire, ils auront la possibilité d’élire de nouveaux gouvernants. Quant aux partis, ils doivent ajuster leurs programmes de sorte à rapprocher l’État du citoyen. Et si on se limitait à ces acceptions fondant l’État de droit, on pourrait dire que les élections du 26 décembre 1991 respectent les normes de la démocratie.
Cependant, tous les pays qui ont accepté l’ouverture démocratique, l’armée a toujours joué un rôle primordial. Dans certains pays, leur rôle était néfaste, comme le résume William Quandt dans « Société et pouvoir en Algérie » en notant à juste titre: « Partout où les régimes ont permis des ouvertures, l’assignation d’un rôle précis aux militaires a constitué un problème de taille : il est extrêmement difficile d’écarter les militaires de la scène politique, comme l’ont montré les cas de la Turquie et du Chili.» Indubitablement, l’Algérie des années quatre-vingt et début des années quatre-vingt-dix ne dérogeait pas à cette règle. L’annulation du second tour des élections législatives corrobore, si besoin est, cette thèse. Quoi qu’il en soit, la confrontation entre les deux acteurs forts du moment, le FIS et l’armée, est due principalement à l’incohérence de l’opposition républicaine, mais aussi à l’incurie du régime à résoudre les problèmes des Algériens. Du coup, l’accès aux responsabilités où leurs conservations ne peuventt intervenir qu’en éliminant l’antagoniste. Mais avant cette confrontation, qui a donné naissance certes au forceps à la démocratie, les Algériens ont accompagné cette période avec effervescence.
- Vers la libération de la parole
Le deuxième mandat de Chadli, après sa réélection en 1984, a été inauguré par une phase de dégringolade de l’économie nationale. La crise a atteint son paroxysme en 1986. En effet, la chute des prix des hydrocarbures, principale ressource du pays, a fait vaciller le régime, bien que ce dernier ait essayé de mieux gérer le budget, en menant une politique d’austérité. Et les méfaits de cette politique n’ont pas tardé à apparaître. En octobre1988, l’Algérie a connu une révolte généralisée. Les manifestants ont crié leur ras-le-bol en prenant pour cible le président de la République, mais aussi le chef du parti unique, Mohand Cherif Messaadia. Grâce à cette révolte, l’idée d’une ouverture démocratique commençait déjà à germer. Dans le film-documentaire « Algérie(s), un peuple sans voix » de Malek Bensamail, deux acteurs importants de l’époque ont exprimé deux visions différentes à propos de l’ouverture démocratique. Si pour Hocine Ait Ahmed, il s’agissait d’une ouverture par effraction tout en estimant que ce droit devait être octroyé depuis belle lurette aux Algériens ; pour Khaled Nezzar, il s’agissait d’une erreur grave de tenter une telle ouverture dans les conditions de l’époque. D’ailleurs, cette dernière position a déjà été soutenue par des membres influents du parti unique lors du congrès de décembre 1988. A la fin de ses travaux, le congrès a adopté une motion avertissant que « dans les conditions actuelles, le multipartisme représente un danger pour le peuple, pour la nation et pour l’unité nationale. » Cependant, en confiant la rédaction de la troisième constitution algérienne aux réformateurs, adoptée pour rappel le 23 février 1989, Chadli a voulu se mettre au-dessus des partis. Mais il a créé également beaucoup de mécontents dans son propre camp. Bien que la nouvelle constitution laisse la liberté de constituer « des associations à caractère politique », les rédacteurs n’ont pas omis d’accroitre les prérogatives du président de la République. Par conséquent, le pouvoir législatif demeurait toujours sous la tutelle du chef de l’État dès lors qu’il pouvait nommer et démettre le chef du gouvernement, dissoudre le parlement comme bon lui semblait. D’ailleurs, le 14 septembre 1989, Chadli a usé de ce droit constitutionnel pour évincer Kasdi Merbah qui ne voulait pas quitter la chefferie du gouvernement en arguant que les députés avaient adopté son programme de politique générale. Néanmoins, avant de partir, Merbah avait pris une décision qui a secoué, deux ans plus tard, les bases de la nation : la légalisation du FIS. Mais si Merbah ne l’avait pas fait, son successeur, Mouloud Hamrouche, l’aurait fait sans réticence.
- Le FIS, un parti pas comme les autres
Le projet de programme politique du FIS, présenté le 7 mars 1989, pouvait être considéré, si on se limitait juste à la lecture du document, comme un programme modéré. En effet, il était question de « concrétiser des idéaux de justice, de liberté et de démocratie. » Cependant, ces principes ont été vite foulés au sol par les discours enflammés des dirigeants du FIS. Ainsi, Ali Belhadj, vice-président du parti, a déclaré dans les colonnes du journal de son parti que « le peuple n’a pas le droit de choisir son souverain qui gouverne selon la charia. » Mais fallait-il comprendre que ce candidat qui allait appliquer la Charia en Algérie serait choisi une seule fois parmi les dirigeants de son parti, et puis il ne serait plus question de le remettre en cause ? En tout cas, c’est la nonchalance et les divisions au sein du régime qui ont facilité l’entrée sur la scène politique d’un parti extrémiste, et ce, bien que la constitution soit claire à ce sujet : pas de reconnaissance des partis fondés sur des bases exclusivement confessionnelles ou régionales. Du coup, dans les mosquées contrôlées par le FIS, c’est-à-dire la majorité ou peu s’en faut, le discours pouvait aller de la solution islamique à la désobéissance civile. Contre toute attente, son discours contestataire a pu capitaliser les aspirations de changement d’une population désemparée. Ainsi, la population qui tirait à hue et à dia a trouvé en le FIS celui qui allait la sauver de l’incurie d’un pouvoir inamovible depuis 1962.
Cependant, dès lors que la voie démocratique a été ouverte, il était normal de tester la représentation des forces politique à travers l’organisation de joutes électorales. En choisissant la prudence, le régime a opté pour les élections locales. Ainsi, le 12 juin 1990, le FIS a remporté une victoire écrasante. Cela dit, le score ne reflétait pas l’adhésion du peuple pour le programme du FIS. Mais force est de constater que la loi électorale l’a tout bonnement favorisé. En effet, l’un des articles de la loi électorale stipule que : « Si aucun parti n’obtenait pas la majorité absolue, le parti au score le plus large recevait la moitié des sièges plus un, le reste étant réparti proportionnellement entre tous les partis ayant obtenu plus de 7% des voix. » Du coup, avec 34% de voix par rapport au nombre d’inscrits, le FIS a remporté 856 communes sur 1500, soit 57%, et 32 Assemblées de Wilayas sur 48, soit 66%.
Par ailleurs, les retombées de cette victoire n’ont pas tardé à se faire sentir. Et sentant que la base le soutenait indéfectiblement, le FIS a commencé à dévoiler sa véritable identité. Les mesures de restrictions dans les communes régies par le FIS ont été innombrables. Pour Lounis Aggoun et Jean Baptiste Rivoire, les mesures qui ont soulevé un vent de panique étaient : « l’interdiction de jouer aux dominos ou aux cartes durant les soirées de ramadan, tentative d’application de la charia dans certaines communes, interdiction de mixité à Alger et à Constantine, constitution de polices des mœurs à Mostaganem, interdits vestimentaires à Jijel, Tipaza et Dellys, suppression du festival du rai à Oran, musique taxée de péché, installation de tribunaux parallèles à Chlef, interdiction d’alcool à Sétif, Annaba et Alger, interdiction de tabac, fermeture de salles de spectacles… » Dans les Républiques qui se respectent, chacune de ces interdictions pouvait provoquer la dissolution immédiate du parti. En dépit de ces abus, le gouvernement a décidé de convoquer les électeurs pour les premières élections législatives sous l’ère du multipartisme.
- Les contradictions au sein du régime
Les premières élections législatives ont été prévues initialement pour le 26 juin 1991. Le gouvernement réformateur, dirigé par M. Hamrouche, a proposé, le 1er avril, la loi électorale régissant ces législatives. La loi était injuste dans la mesure où le découpage électoral allait favoriser tacitement la future coalition FLN réformateur-FFS de Hocine Ait Ahmed. Toutefois, à partir du moment où le FIS paraissait infréquentable, logiquement cette démarche aurait dû réjouir le pouvoir dans tous ses segments. Le début de la campagne a été prévu pour le 2 juin. Jusque-là le parti d’Abassi n’a pas encore opté pour le moyen à employer pour perturber la partie. C’est à partir de Tlemcen, le 14 mai 1991, que le leader du FIS a décidé de lancer une grève générale illimitée à partir du 25 mai. Il a averti les dirigeants en usant d’un langage guerrier : « Si l’armée intervient, nous nous battrons. Si une goutte de sang venait à couler, je jure par Dieu que nous nous battrons jusqu’à l’anéantissement. » Cette déclaration valait amplement la dissolution du FIS. Contre toute attente, c’est M. Hamrouche qui a été poussé à quitter le gouvernement, et ce, malgré le bilan calamiteux de la grève, deux jours après son lancement, comme l’a fait remarquer Yves Heller du Monde en notant : « mis à part quelques affiches qui appelaient au mouvement, rien n’indiquait qu’une grève générale ait lieu… Le monde du travail n’a pas répondu à l’appel ; pis, des débrayages prévus de longue date, comme celui des aiguilleurs du ciel, sont suspendus dés que commence la grève du FIS. » Quant au syndicat islamiste, le SIT en l’occurrence, celui-ci a appelé à la grève pour le 1er juin, alors que le parti l’avait lancée le 25 mai. Toutefois, la démission de Hamrouche le 4 juin et la proclamation de l’état de siège le 5 juin ont induit l’annulation systématique des élections législatives.
Cependant, la vacance du poste de chef de gouvernement a été aussitôt palliée. Ainsi, Sid Ahmed Ghozali, qui se trouvait au Nigéria pour représenter Chadli, a été appelé d’urgence. Voila comment a-t-il raconté cet épisode : « Quand l’état de siège a été décrété, le président de la République m’a envoyé un avion spécial pour me faire rentrer à Alger et c’est là qu’il m’a proposé je dirai presque imposé d’accepter la mission de chef de gouvernement. » Par ailleurs, dés le 7 juin 1991, le nouveau chef du gouvernement a annoncé la tenue des élections législatives, propres et honnêtes, avant la fin de l’année, et ce, après avoir rencontré les deux leaders du FIS. Selon W.Quandt : « Madani était toujours décidé à présenter cette victoire comme une victoire, et déclara que l’état de siège n’était pas dirigé contre le FIS. En fait, il semblait se satisfaire du départ de Hamrouche. » D’ailleurs, comment il ne pourrait pas l’être, puisque Ghozali a décidé de revoir la loi électorale en portant le nombre de députés à 430 au lieu des 295 proposés par Hamrouche.
- Vers la tenue des élections
La démission de Hamrouche signifie, par ricochet, que Chadli avait perdu un allié de taille. Bien qu’il se soit maintenu, dans le second semestre de 1991, les véritables forces du pays étaient désormais l’armée et le FIS. Quant au nouveau chef du gouvernement, sa mission se limite à l’organisation des élections législatives. Toutefois, bien que les leaders du FIS soient emprisonnés le 30 juin, le FIS a l’occasion de se restructurer autour de son nouveau leader, Abdelkader Hachani. Le 12 octobre, Sid Ahmed Ghozali propose aux députés d’adopter la nouvelle loi électorale. Pour W. Quandt, « le nouveau premier ministre Sid Ahmed Ghozali avait promis l’organisation d’élections libres et honnêtes, avec une nouvelle loi électorale, ce qui pouvait ressembler aussi à une victoire du FIS. » Dans la foulée, Chadli annonce également la tenue des législatives pour le 26 décembre 1991. Avant d’ajouter que « le second tour pourrait se tenir le 16 janvier 1992. »
Par ailleurs, à un mois des élections, un fait grave s’est produit à la frontière algéro-tunisienne. En effet, le 28 novembre, un groupe armé a pris d’assaut la caserne de Guemmar. Le ministre de la Défense, Khaled Nezzar, se rend tout de suite sur les lieux. Il affirme, sans qu’il y ait la moindre enquête que « les auteurs de cette attaque sont indirectement liés au FIS. » Hélas, cette énième occasion de dissoudre le FIS n’a pas été non plus saisie. Toutefois, les walis ont été chargés, dés le 6 décembre, par une nouvelle loi, de faire appel à l’armée pour les aider dans leur mission. Ce qui pouurait être interprété comme un moyen de contourner la volonté du président si jamais il refusait de décréter l’état de siège au moment idoine. À douze jours du scrutin, le FIS décide enfin de participer aux élections. Pendant la campagne électorale, les responsables des partis sillonnent le pays pour expliquer leurs programmes. Enfin, Chadli clôture la campagne par un discours où il dit qu’il serait prêt à gouverner avec le parti vainqueur, quel qu’il soit, et ce, dans le respect de la constitution du 23 février 1989. Malgré les tensions tous azimuts, les premières élections majeures et pluralistes ont bien lieu, le 26 décembre 1991. Comme en juin 1990, la victoire du FIS est écrasante. Le mode de scrutin et la nouvelle loi électorale sont déterminants dans cette victoire, car les Algériens n’ont pas voté, encore une fois, massivement pour le FIS. Ainsi, sur 13,3 millions d’inscrits, 3260359 électeurs ont voté pour le FIS. Ce résultat le place naturellement à la première position derrière le FLN avec 1613507 voix et le FFS avec 510661 voix. Or le nombre de sièges remportés ne reflétait pas le poids électoral de chaque parti. Le FIS est arrivé en tête avec 188 sièges suivi du FFS avec 25 sièges et enfin du FLN avec 15 sièges. Ainsi, en analysant les chiffres, il fallait en moyenne 17340 voix pour élire un député FIS, 22426 pour élire un député FFS et 107633 voix pour élire un député FLN. Et si la représentation proportionnelle avait été choisie, le FIS n’aurait en aucun cas remporté la majorité de sièges. Son score se serait situé aux alentours de 30%. Et la coalition des autres partis aurait même privé le FIS de diriger le gouvernement.
Cette victoire, au goût amer, va diviser la classe politique quant à la poursuite ou non du processus électoral. Au sein du gouvernement, on pense déjà la manière d’arrêter le processus électoral. Une commission composée de deux civils et deux militaires désigne le général Nezzar pour rencontrer Chadli. Résultat des tractations : le président accepte de démissionner. Il accepte également de dissoudre le parlement. Au journal télévisé de 2Oheures, ce 11 janvier 1992, Chadli a remis sa démission au président du conseil constitutionnel, Abdelmalek Benhabyles. Devant ce vide juridique, le HCS (Le Haut Conseil de Sécurité) met un terme au processus électoral. Cet organe consultatif, réuni normalement à l’initiative du président de la République, décide alors de siéger sans discontinuer. La parenthèse démocratique sera refermée après plus de deux ans de pluralisme. En effet, bien que des hommes sincères aient occupé des responsabilités [je pense notamment à Liamine Zeroual], force est de constater que tous ont reconduit l’état de siège sine die. L’abrogation de cette loi après les révoltes nord-africaines ne change rien à la donne.
Boubekeur Ait Benali
/image%2F0550898%2F20140525%2Fob_99d0a9_1239956-10201186905929778-1978754431-n.jpg)

/image%2F0550898%2F20140415%2Fob_15e789_1007084593.jpg)


 Lorsque le peuple algérien s’est libéré du joug colonial, un système de domination inhumain, tout le monde s’attendait à ce que les libertés soient inscrites en lettres d’or dans les
futures institutions de l’État algérien. Hélas, au moment où le pays a accédé à l’indépendance, les troupes stationnées aux frontières, sous l’égide de Boumediene, ont décidé de replonger le
peuple algérien dans une autre ère de sujétion. Ainsi, malgré le progrès observé dans le monde, le même système prévaut, cinquante ans plus tard, en Algérie. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que dans cet intervalle de temps, entre les hommes stoïques de novembre 1954 et ceux d’aujourd’hui, on dirait qu’on a affaire à deux peuples distincts.
Lorsque le peuple algérien s’est libéré du joug colonial, un système de domination inhumain, tout le monde s’attendait à ce que les libertés soient inscrites en lettres d’or dans les
futures institutions de l’État algérien. Hélas, au moment où le pays a accédé à l’indépendance, les troupes stationnées aux frontières, sous l’égide de Boumediene, ont décidé de replonger le
peuple algérien dans une autre ère de sujétion. Ainsi, malgré le progrès observé dans le monde, le même système prévaut, cinquante ans plus tard, en Algérie. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que dans cet intervalle de temps, entre les hommes stoïques de novembre 1954 et ceux d’aujourd’hui, on dirait qu’on a affaire à deux peuples distincts. Le recours sans cesse à la révision de la constitution renseigne immanquablement sur la fragilité du système politique algérien. En règle générale, notamment dans les pays où le
pouvoir réel est détenu par le peuple, les éventuelles modifications du texte fondamental conduisent à renforcer davantage le contrôle du peuple sur les institutions. Hélas, en Algérie, depuis
l’indépendance, le pouvoir s’exerce en dehors du peuple. Du coup, l’annonce de la nouvelle révision constitutionnelle ne suscite pas d’engouement particulier dans la société. Et pour cause ! Bien
qu’on puisse épiloguer sur les motivations de chaque président, depuis l’élaboration de la constitution en 1963 [un texte rédigé, pour rappel, en dehors de l’hémicycle] à celle de novembre 2008,
ces textes ne visent qu’à renforcer, de façon considérable, les prérogatives du chef de l’État au détriment des contre-pouvoirs.
Le recours sans cesse à la révision de la constitution renseigne immanquablement sur la fragilité du système politique algérien. En règle générale, notamment dans les pays où le
pouvoir réel est détenu par le peuple, les éventuelles modifications du texte fondamental conduisent à renforcer davantage le contrôle du peuple sur les institutions. Hélas, en Algérie, depuis
l’indépendance, le pouvoir s’exerce en dehors du peuple. Du coup, l’annonce de la nouvelle révision constitutionnelle ne suscite pas d’engouement particulier dans la société. Et pour cause ! Bien
qu’on puisse épiloguer sur les motivations de chaque président, depuis l’élaboration de la constitution en 1963 [un texte rédigé, pour rappel, en dehors de l’hémicycle] à celle de novembre 2008,
ces textes ne visent qu’à renforcer, de façon considérable, les prérogatives du chef de l’État au détriment des contre-pouvoirs. Depuis l’avènement des premières révolutions jusqu’à celles de Tunisie, d’Égypte et
même de Lybie, le personnel politique se retrouve, à chaque fois, renouvelé soit totalement soit en partie. En Algérie, en dépit du lourd tribut payé par les Algériens en 1988, les dirigeants,
qui ont mené le pays à la banqueroute, se sont maintenus sans ambages à la tête de l’État. À ce titre, bien que les dirigeants actuels s’ingénient à trouver des formules de comparaison entre les
événements d’octobre 1988 et « les printemps arabes », force est de reconnaitre que les différentes situations sont loin d’être semblables.
Depuis l’avènement des premières révolutions jusqu’à celles de Tunisie, d’Égypte et
même de Lybie, le personnel politique se retrouve, à chaque fois, renouvelé soit totalement soit en partie. En Algérie, en dépit du lourd tribut payé par les Algériens en 1988, les dirigeants,
qui ont mené le pays à la banqueroute, se sont maintenus sans ambages à la tête de l’État. À ce titre, bien que les dirigeants actuels s’ingénient à trouver des formules de comparaison entre les
événements d’octobre 1988 et « les printemps arabes », force est de reconnaitre que les différentes situations sont loin d’être semblables.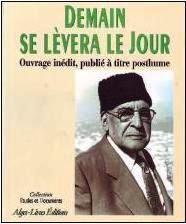 « À vouloir agir en dehors du peuple, on arrive à des résultats
diamétralement opposés aux véritables objectifs socialistes et égalitaires », extrait de la lettre de démission de Ferhat Abbas, le 12 aout 1963.
« À vouloir agir en dehors du peuple, on arrive à des résultats
diamétralement opposés aux véritables objectifs socialistes et égalitaires », extrait de la lettre de démission de Ferhat Abbas, le 12 aout 1963. La question du pouvoir en Algérie aurait pu être réglée sans violence si la propension de certains dirigeants à ériger un pouvoir personnel avait été mise de côté. En plus, la découverte
du pétrole, dans la deuxième moitié des années cinquante, aurait pu faciliter la réalisation des desiderata du peuple algérien. Néanmoins, bien que la France ait retardé l’indépendance du pays
de six ans, après la découverte du pétrole à Edjeleh et à Hassi Messaoud en 1956, il n’en demeure pas moins que l’action des maquis intérieurs et les efforts accomplis par la diplomatie
algérienne finiront par apporter leur fruit en 1962.
La question du pouvoir en Algérie aurait pu être réglée sans violence si la propension de certains dirigeants à ériger un pouvoir personnel avait été mise de côté. En plus, la découverte
du pétrole, dans la deuxième moitié des années cinquante, aurait pu faciliter la réalisation des desiderata du peuple algérien. Néanmoins, bien que la France ait retardé l’indépendance du pays
de six ans, après la découverte du pétrole à Edjeleh et à Hassi Messaoud en 1956, il n’en demeure pas moins que l’action des maquis intérieurs et les efforts accomplis par la diplomatie
algérienne finiront par apporter leur fruit en 1962. Vers la fin de la guerre d’Algérie, le citoyen lambda se dit, dans son for intérieur, que son statut subalterne ne sera qu’un mauvais souvenir. Se contentant de faire face aux dangers
qui le guettent journellement, il ne sait pas qu’un groupe de militaires a scellé le sort de l’Algérie avant le cessez-le-feu. Cela dit, bien qu’il accueille la fin de la colonisation avec la
grande hilarité, il n’en reste pas moins que cette euphorie ne s’est pas prolongé longtemps. Désormais, il assiste impuissant à la lutte fratricide pour le pouvoir. Quoi qu’il en soit, bien qu’un
mouvement révolutionnaire puisse envisager l’emploi de la violence contre un système colonial ne choque pas, mais dès lors qu’il la retourne ensuite contre son peuple, cela laisse sans
voix.
Vers la fin de la guerre d’Algérie, le citoyen lambda se dit, dans son for intérieur, que son statut subalterne ne sera qu’un mauvais souvenir. Se contentant de faire face aux dangers
qui le guettent journellement, il ne sait pas qu’un groupe de militaires a scellé le sort de l’Algérie avant le cessez-le-feu. Cela dit, bien qu’il accueille la fin de la colonisation avec la
grande hilarité, il n’en reste pas moins que cette euphorie ne s’est pas prolongé longtemps. Désormais, il assiste impuissant à la lutte fratricide pour le pouvoir. Quoi qu’il en soit, bien qu’un
mouvement révolutionnaire puisse envisager l’emploi de la violence contre un système colonial ne choque pas, mais dès lors qu’il la retourne ensuite contre son peuple, cela laisse sans
voix.